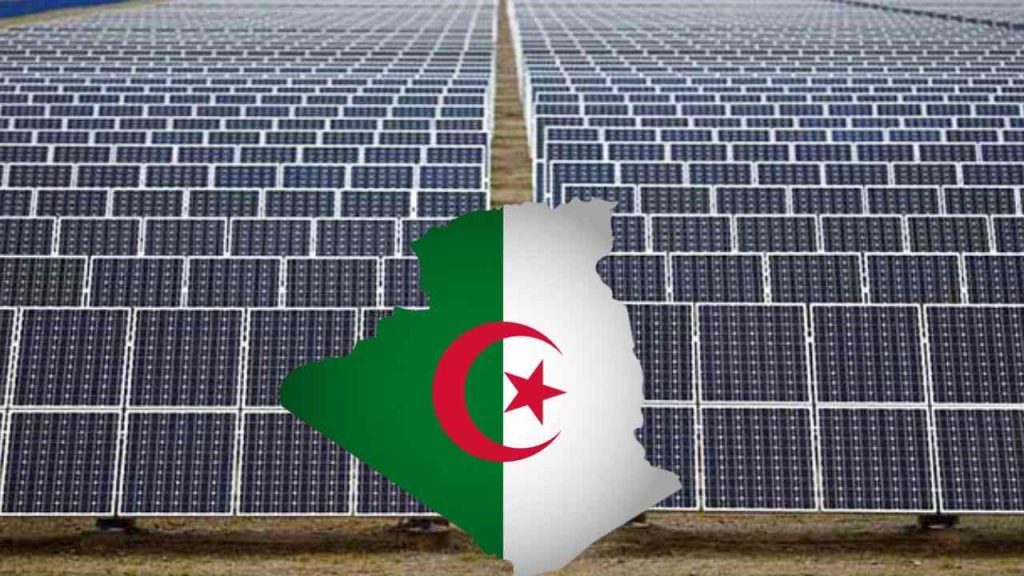Invité sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, le directeur général du cluster Green Energy Algeria, Boukhalfa Yaïci, a dressé un état des lieux nuancé du programme algérien de développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire.
Ainsi, malgré une ambition affirmée de produire 15.000 mégawatts d’énergie renouvelable d’ici 2035, le chemin reste semé d’embûches.
Un projet solaire lancée mais sous pression
Premier jalon de cette transition énergétique, l’appel d’offres lancé en février 2023 a débouché sur la signature de contrats en mars 2024 pour la réalisation de 3200 mégawatts en trois tranches (2000, 1000 et 200 MW). Les chantiers sont aujourd’hui en cours, avec une durée de réalisation prévue entre 10 et 24 mois.
Mais selon M. Yaïci, les débuts ont été laborieux. « Toutes les parties prenantes n’étaient pas prêtes », affirme-t-il, expliquant que l’absence prolongée de projets dans le domaine avait éteint toute visibilité pour les investisseurs jusqu’à la relance du programme décidée fin 2022 par le président de la République. Résultat : de nombreuses entreprises n’étaient pas préparées à répondre aux exigences techniques des appels d’offres.
Si 30 % du marché ont été remportés par des entreprises algériennes, nombre d’entre elles ont rapidement déchanté. Faute de compétitivité et de soutien adapté, certaines ont même mis la clé sous la porte. M. Yaïci évoque le cas de producteurs locaux de panneaux solaires : « Ils avaient investi sur instruction des pouvoirs publics, mais se sont retrouvés sans débouchés ».
Des freins réglementaires persistants
Le principal écueil selon lui : un décalage entre la capacité de production locale (jusqu’à 410 watts par panneau) et les exigences des cahiers des charges (560 à plus de 600 watts). À cela s’ajoute une inapplication du décret exécutif de 2020, censé faciliter la fabrication locale via une réduction des droits de douane sur les intrants, mais resté lettre morte faute de texte d’application.
Le cadre juridique lui-même freine l’élan. Un décret de 2017, autorisant le recours au modèle IPP (producteurs indépendants d’électricité), n’a toujours pas été activé, ce qui prive le secteur d’un outil d’investissement souple et attractif. « Il faut commencer par appliquer les décrets existants », plaide Yaïci, qui appelle aussi à une stabilité réglementaire, notamment pour sécuriser les engagements des investisseurs.
Un manque de clairvoyance déploré
Autre défi : l’absence de vision au-delà des 3200 MW. « C’est la grande question : que va-t-on faire après ? » s’interroge-t-il. C’est pourquoi Il appelle à préparer l’après-3200 MW dès aujourd’hui, en intégrant davantage d’entreprises locales, y compris issues du secteur pétrogazier, et en explorant des mécanismes de financement mixte, publics et privés.
Pour sortir de l’impasse, M. Yaïci suggère de développer des modèles économiques alternatifs, axés sur des projets solaires de petite échelle à destination des agriculteurs ou des industriels isolés. « On peut créer des producteurs indépendants qui vendent de l’électricité aux agriculteurs », indique-t-il, tout en insistant sur le fait que ces projets nécessitent des financements limités et sont à la portée des entreprises locales.
Il appelle aussi à « ouvrir de nouveaux segments de marché », là où les panneaux de 410 watts suffisent, notamment dans l’agriculture saharienne, évitant ainsi de tirer de longues lignes électriques.
L’hydrogène vert, un enjeu stratégique
Enfin, le responsable évoque l’enjeu naissant de l’hydrogène vert, notamment dans le cadre du projet SoutH2 Corridor. Il estime que l’Algérie, dotée de soleil, d’espace et de ressources hydriques, a tous les atouts pour devenir un leader régional. Mais cela suppose des investissements étrangers, notamment allemands, et un positionnement clair sur la scène internationale.
Face à la montée des exigences carbone dans les marchés d’exportation, M. Yaïci alerte : sans transition énergétique efficace, des produits comme les dattes ou d’autres marchandises utilisant de l’énergie fossile risquent de perdre leur accès à certains marchés.
Une « école » à ne pas dilapider »
Le programme des 3200 mégawatts est, selon lui, « une vraie école ». Mais il met en garde contre la tentation de repartir de zéro après cette étape. « Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Il faut élargir et approfondir la stratégie actuelle ».
En somme, pour M. Yaici la transition énergétique algérienne est bien engagée, mais elle reste fragile, tributaire de décisions politiques, de soutiens réglementaires clairs et d’un pilotage stable. Si elle réussit son virage solaire, l’Algérie pourrait bien devenir un acteur énergétique majeur dans la région.