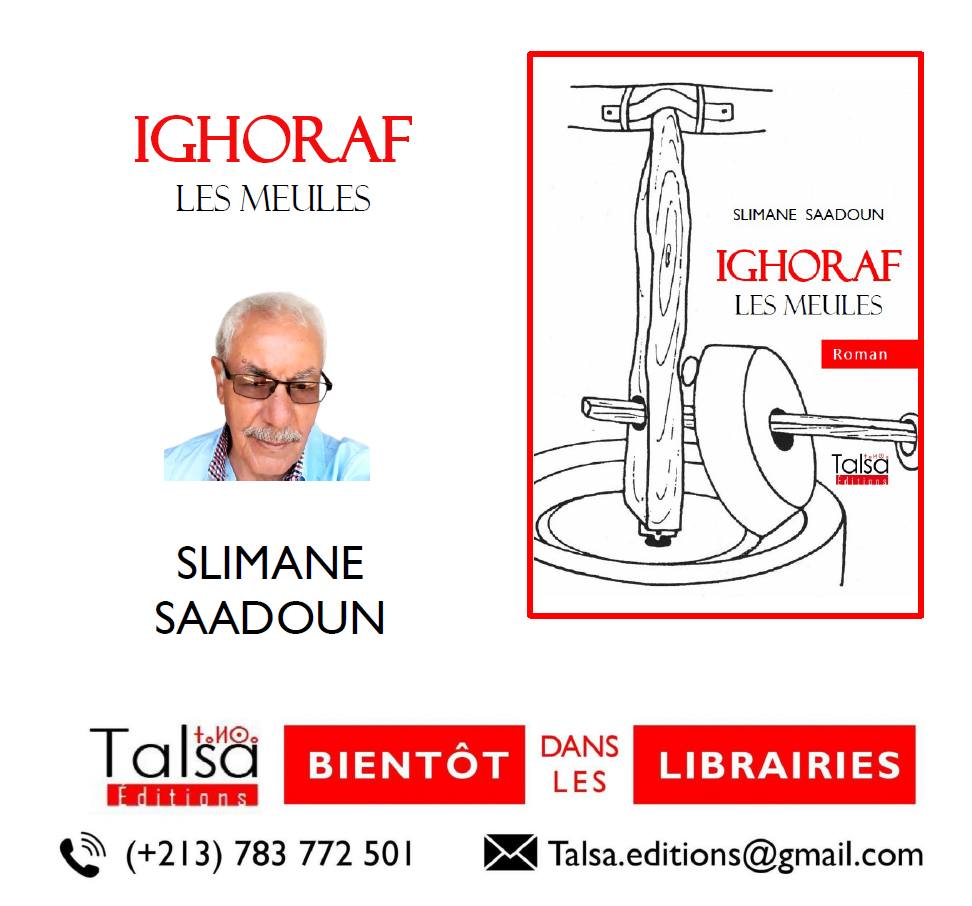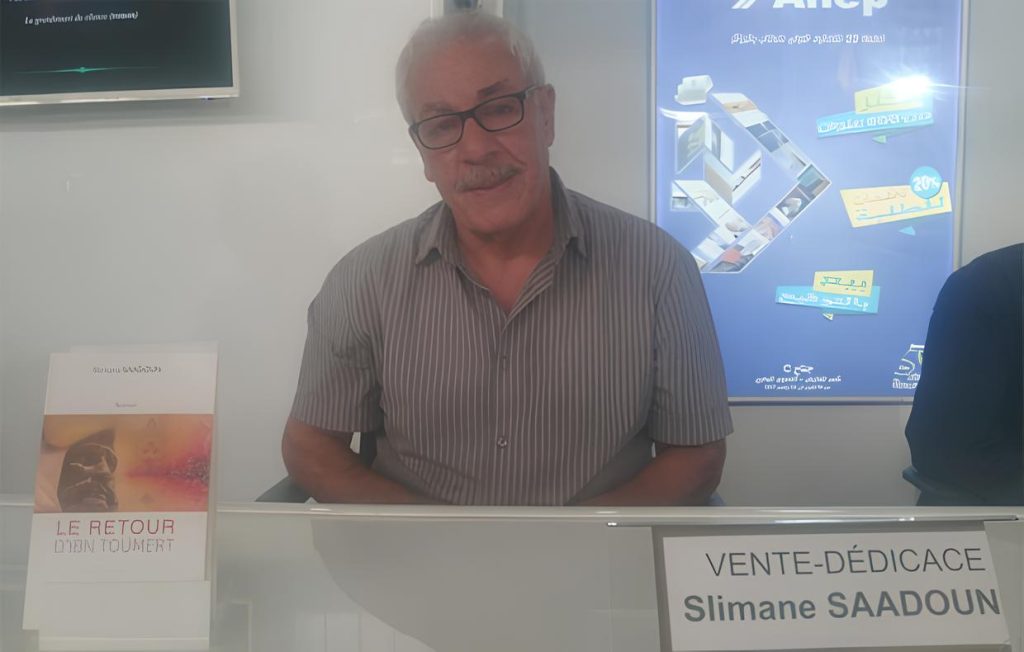Après « Lalla n’Ouerdja, la révoltée » et « Le retour d’Ibn Toumert », ses deux derniers ouvrages, Slimane Saâdoun, revient avec un nouvel opus intitulé : « Ighoraf-Les meules ».
Ainsi, le natif de la commune de Haïzer, dans la wilaya de Bouira, qui s’est imposé avec le temps comme l’un des auteurs les plus talentueux et prolifiques de sa génération, vient de publier aux éditions «Talsa» basées dans la commune d’Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, un roman mettant en relief le « poids » de la société qui pèse sur la jeunesse.
Telle une meule, d’où le titre de l’ouvrage, le poids de la société, ses contradictions et obsessions kafkaïennes, écrase, lamine et réduit en poussière, les espoirs ambitions et les rêves d’une jeunesse désenchantée. Cette dernière, est écartelée et écrasée entre d’une part, l’ardente envie de s’émanciper, de « brûler la vie par les deux bouts », laisser éclater sa fureur de vivre, et de l’autre, le conservatisme, voire l’obscurantisme d’une société figée dans le temps, sclérosée par un archaïsme anachronique et « meurtrier ». Slimane Saâdoun, à travers son ouvrage, relate non seulement les tares d’une société pathogène, mais aussi les souffrances et la « schizophrénie » des jeunes et surtout les femmes, qui en pâtissent.
Double culture, double « malédiction »
En effet et selon l’auteur, ce roman trouve sa genèse dans un constat aussi limpide qu’édifiant « la plupart des romanciers francophones que j’ai pu lire, pour ne pas dire tous, sont confrontés à un conflit intérieur, dû à une double culture. Un conflit à la limite de la dissociation de la personnalité », a-t-il confié. Afin d’illustrer ses propos, Slimane Saâdoun citera l’exemple de la poétesse Taousse Amrouche, qui à cause de cette double culture, ne savait plus si elle était française ou algérienne. « Je peux également citer Mouloud Maameri, qui a grandi à Ath Yenni, avec son mode de vie, ses croyances, sa langue maternelle et quand il est entré au collège, cela fut un choc pour lui : Une autre langue, une autre religion, d’autres habitudes (…) », soulignera l’auteur. Pour ce dernier, ce « malaise » dont sont victimes la plupart des auteurs francophones algériens, peut être aisément calqué sur l’ensemble de la société algérienne, notamment durant les années de braises où la jeunesse était déchirée entre un rigorisme et fanatisme idéologique dévastateur et l’envie irrépressible de… vivre. Tout simplement.
Les années 1970 une époque charnière…
Ainsi, le roman « Les Meules » relate le cheminement parfois, voire souvent, tortueux et infernal, lequel conduit irrémédiablement vers « la haine de soi ». D’après l’auteur, la trame du roman se déroule dans les années 1970, dans une Algérie qui sort à peine de 132 ans de colonialisme, lequel avait déjà mis en œuvre le « grand remplacement » à tous les niveaux.
La société algérienne de l’époque, était déchirée, écartelée et aux prises entre deux cultures diamétralement opposées. Celle de l’« Algérie profonde » ou la pudeur excessive et le conservatisme étouffant étaient érigés en règles absolues et de l’autre, l’Algérie du « tunnel des facultés » du « Milk Bar », et du «Tontonville», où des femmes d’une beauté envoûtante embaumées par le dernier Yves Saint Laurent, se pavanant sur la mythique Rue d’Isly (actuellement le Boulevard Larbi Ben M’hidi). « À cette époque, il y’avait une espèce de trouble dans le comportement des gens, dans leur mentalité. Ils étaient désorientés. Ils étaient perdus entre la modernité et le conservatisme », a-t-il tenu à souligner. Selon le romancier, c’était une époque charnière de l’Algérie poste indépendante, où les jeunes étaient pris entre deux meules (Ighoraf) et ne savaient plus quel chemin prendre et la femme était doublement pénalisée dans ce tiraillement de la société.
Quatre “progressistes” en plein doute
Dans ce contexte particulier, l’auteur relate le parcours, les interrogations et les tumultes de quatre jeunes : Laz, Akli, Aker et Amjah, tous instruits à l’école coloniale et confrontés à la société algérienne en pleine quête de son identité.
Selon M. Saâdoun, ces personnages, disons « progressistes » sont partagés entre les valeurs inculquées par l’école française, à savoir l’universalisme, les valeurs humaines intrinsèques et le conservatisme religieux, voire l’islamisme fondamentaliste qui était à l’époque à ses balbutiements. « Ils sont déchirés entre leur désir de construire un monde nouveau fondé sur des valeurs humanistes et d’ouverture et leur difficulté à assimiler les règles de la communauté », fera-a-t-il remarquer.
Slimane Saâdoun, à travers cette œuvre, met en exergue le délicate exercice d’adaptation d’une jeunesse en mal de repères et d’identité. Une jeunesse, confrontée à une double culture, une double « identité culturelle » et à qui la société reproche leur « égarement ». Des brebis galeuses, dont le seul tort et d’avoir eu le « malheur » d’avoir connu une école Républicaine, éloignée de toute idéologie et de tout fanatisme.