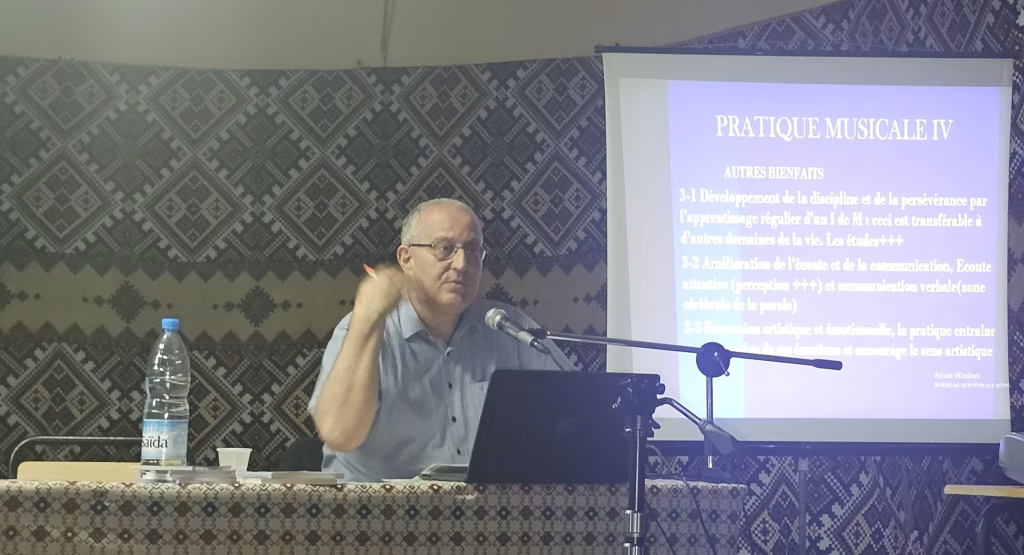Le docteur Mouloud Ounnoughene, neurochirurgien, musicien et essayiste, était ce samedi 21 juin 2025, l’hôte de l’Institut régional de la musique de Bouira, dans le cadre des festivités de la fête de la musique, célébrée chaque 21 juin.
Ainsi, lors de cet évènement qui s’est déroulée au niveau du siège dudit Institut et organisé par l’ « Association El Amraouia El Andaloussia », le Dr Ounnoughene, a animé une conférence-débat, durant laquelle, il a démontré les vertus thérapeutiques et insoupçonnées de la musique sur la santé mentale et neurologique.
Quand la musique « active » le cerveau
En effet, le docteur Ounnoughene n’est pas un praticien ordinaire. Neurochirurgien de profession, il est aussi musicien, essayiste, et auteur de plusieurs ouvrages où il mêle savoir scientifique et culture musicale. « Aujourd’hui, je donne une conférence sur les bienfaits de la musique sur la santé. J’ai déjà publié deux ouvrages à ce sujet : la musique autrement, de la note à la thérapie et L’influence de la musique sur le comportement humain », déclare-t-il.
Pour notre interlocuteur, dès les premières notes, la musique mobilise de vastes régions cérébrales. « Lorsqu’on joue d’un instrument, on utilise nos mains, nos pieds, notre audition, notre mémoire… Tout cela allume plusieurs zones cérébrales simultanément », explique le conférencier. Il souligne ainsi un phénomène clé : la neuroplasticité, c’est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier et à créer de nouvelles connexions. Selon lui, les enfants qui pratiquent la musique développent davantage leur motricité, leur audition et leur mémoire.
Un rempart contre les maladies neurodégénératives
Par la suite, l’intervenant indiquera que des études menées notamment par les chercheurs Hervé Platel et Groussard confirment que la pratique musicale régulière réduit les risques de développer la maladie d’Alzheimer. « Les musiciens assidus bénéficient d’une protection cérébrale, en particulier au niveau de l’hippocampe, qui joue un rôle clé dans la mémoire », précise le Dr Mouloud Ounnoughene. Pour ces raisons, il milite pour une reconnaissance sérieuse de la musicothérapie, encore marginalisée en Algérie.
La musicothérapie, un outil précieux face à l’autisme
Par ailleurs, la musique offre des perspectives prometteuses pour les enfants autistes. Des recherches récentes ont mis en lumière des particularités neurologiques chez ces enfants, notamment des anomalies dans la zone de Broca.
En réponse, des protocoles adaptés de rééducation rythmique permettent de stimuler des zones cérébrales défaillantes. « Les enfants autistes réagissent fortement aux sons, aux rythmes, aux percussions. On note des améliorations significatives dans la communication non verbale », affirme le docteur, citant des études cliniques menées à Aix-Marseille et ailleurs.
Le pouvoir cathartique de la musique
La musique a également un pouvoir émotionnel profond. « En cas de dépression, elle peut provoquer une véritable catharsis, c’est-à-dire une libération d’émotions », explique-t-il, en s’appuyant sur les écrits d’Aristote. Des morceaux bien choisis peuvent aider les individus à extérioriser leur douleur, à pleurer, puis à ressentir un soulagement.
Musique et mémoire : l’alliée des patients Alzheimer
Pour être efficace contre la maladie d’Alzheimer, la musicothérapie doit reposer sur deux principes : la mémoire autobiographique et la répétition. En utilisant des morceaux que le patient aimait dans sa jeunesse, on observe des signes de reconnexion émotionnelle. « Le regard s’éclaire, le visage s’anime… Cela prouve que le message musical a été reçu », raconte-t-il. Il évoque ses propres compositions, testées sur des patients, et ayant suscité des réactions inattendues.
Parkinson et le rythme pour retrouver la marche
La musique joue également un rôle dans la rééducation motrice. Chez les patients atteints de Parkinson, l’introduction de rythmes binaires (type tambour) permet de réguler la marche et de restaurer une fluidité du mouvement. « Des études canadiennes ont prouvé que ces stimulations rythmiques améliorent la fonctionnalité des patients, en augmentant même leur niveau de dopamine », indique le Dr Ounnoughene. La dopamine, connue pour procurer du plaisir, joue également un rôle dans la motricité.
L’héritage oublié des “maqams thérapeutiques”
Revenant sur l’histoire, le conférencier rappelle que la musicothérapie n’est pas une invention moderne. « Au XVe siècle, l’Empire ottoman avait déjà créé des hôpitaux où l’on soignait avec des maqams, des chants d’oiseaux, ou encore le bruit des fontaines », raconte-t-il. Les maqams orientaux tels que Bayati, Hijaz ou Haras génèrent respectivement des sentiments de joie, d’évasion, ou de puissance.
Enfin, la musique peut aussi aider à retrouver un calme intérieur. À l’Institut von Karajan de Salzbourg, des morceaux longs et lents sont utilisés pour inciter les patients à respirer profondément. « En respirant lentement, on active le système parasympathique, ce qui diminue le rythme cardiaque et apaise le stress », conclut-il.
La musique, une médecine silencieuse
Par cette conférence, le docteur appelle à une prise de conscience : la musique ne doit plus être considérée comme un simple divertissement. Elle est une véritable médecine douce, capable de prévenir, d’apaiser, voire de guérir. Son combat : démocratiser la musicothérapie, faire entrer les vibrations harmoniques dans les protocoles de soins, et redonner à la musique sa pleine dimension thérapeutique.