Paris continue de s’entêter à vouloir soumettre Alger. La France maintient sa stratégie qui consiste à exercer des pressions politiques en mettant de coté l’option diplomatique, soutenue par des voix sages dans l’Hexagone.
Ainsi et quitte à sacrifier les contrats commerciaux dont vivent des milliers d’entreprises françaises, la France sombre dans sa politique jusqu’au-boutiste vis-à-vis de l’Algérie. Un aspect savamment ignoré par ces responsables politiques qui ont fait de l’Algérie, pendant des mois, le leitmotiv de leur politique interne.
En effet, c’est en dehors des primes times et des heures de grande audience que la vraie question est débattue, analysée, décryptée et interrogée : qu’adviendra-t-il des contrats commerciaux entre la France et l’Algérie.
Au moment où des plateaux sont consacrés à l’électricité dans la relation entre la France et l’Algérie dont le motif se réduit tel un entonnoir au refus d’Alger de reprendre ses ressortissants sous OQTF et la libération de l’écrivain Boualem Sansal, des opérateurs économiques français sont pris de panique.
Panique à la CCIFA
Leurs parts de marché en Algérie se sont effondrées. Certains secteurs se sont retrouvés ainsi, du jour au lendemain, au niveau zéro export vers le marché algérien qui représentait, au moins, la moitié des débouchés de leurs produits. Il en est de même pour les privilèges et faveurs accordés aux entreprises et représentations françaises opérant en Algérie.
Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Algérienne, CCIFA, Michel Bissac a tiré la sonnette d’alarme sur les pertes financières suite à l’arrêt des importations algérienne de France et le risque de banqueroute qui pèse sur des centaines d’entreprises françaises qui vivent du marché algérien. Il a ainsi évalué les partes à 5 milliards d’euros, 4,8 milliards, précisément si l’Algérie décidé, comme elle l’avait fait auparavant avec l’Espagne, d’arrêter ses importations de produits français. Et ce sont pas moins de 6000 entreprises françaises qui se retrouveront, selon lui, « ne grande difficulté ». Parce qu’elles auront perdu leur principal et avantageux marché. Et où elles bénéficiaient d’un régime préférentiel. Mais pas que.
6000 entreprises françaises sur le carreau ?
L’Algérie s’est aussi, dans une nouvelle stratégie économique, orientée vers d’autres partenaires pour diversifier ses fournisseurs tout en mettant fin aux contrats d’assistance, d’étude et de gestion de nombreuses entreprises et bureaux d’étude français. L’Algérie a ainsi mis fin aux contrats liant des entités et entreprises nationales à des sociétés et groupes français dont Suez liée avec la Seaal pour la gestion de l’eau et l’assainissement d’Alger et Tipaza, La Ratp avec le Métro d’Alger, ADP avec l’aéroport d’Alger.
Plus globalement, des voix commencent à se faire entendre en se démarquant d’emblée de l’ambiance politique qui grève sérieusement le business avec l’Algérie de nombreux groupes économiques français.
Une perte sèche de 18 Mds d’euros pour la France
On évoque d’ores et déjà une perte sèche de 18 milliards d’euros alors que les céréaliers français dont le marché algérien absorbait 50% de leur production se retrouvent exclu, l’Algérie ayant opté pour de nombreux autres fournisseurs de blé tendre dont la Russie, l’Ukraine, l’Italie…
La tension entre Paris et Alger est en partie en cause, mais pas que. La décision de l’Algérie de réduire ses importations s’est accompagnée d’investissements massifs dans les domaines industriel et agricole, souvent en partenariat. Elle est accompagnée aussi d’une diversification de ses partenaires et fournisseurs en se tournant vers la Chine, la Russie, l’Italie, l’Espagne et d’autres pays d’Amérique latine.
Les groupes français sont invisibles dans les contrats de partenariats conclus dans les domaines de l’énergie, l’industrie automobile, la sidérurgie, les mines, les transports dont l’immense chantier du chemin de fer, les travaux publics, etc.
Plus aucun grain de blé français !
Des marchés publics auxquels les entreprises françaises avaient l’accès prioritaire comme stipulé dans une disposition des accords de 1968. Même ces accords que les voix de la droite et l’extrême droite françaises appellent à dénoncer étaient initialement plus avantageux pour la partie française.
Des avantages que l’on découvre dans la structure juridique de Total lubrifiants Algérie détenu à 100% par le groupe énergétique français alors que cette filiale a été créée au moment où le code du travail algérien imposait un partenariat 51/49. Jusqu’à ces prix symboliques de location et la gratuité des biens immobiliers abritant les différentes représentations françaises en Algérie.
L’Algérie a décidé enfin d’imposer la réciprocité en invitant Paris à venir négocier « les nouveaux tarifs », pour utiliser une formule peu diplomatique. Et c’est là l’expression de la souveraineté que les responsables algériens ont souvent évoquée lorsqu’ils parlent de relations bilatérales, de coopération ou de partenariat économique.

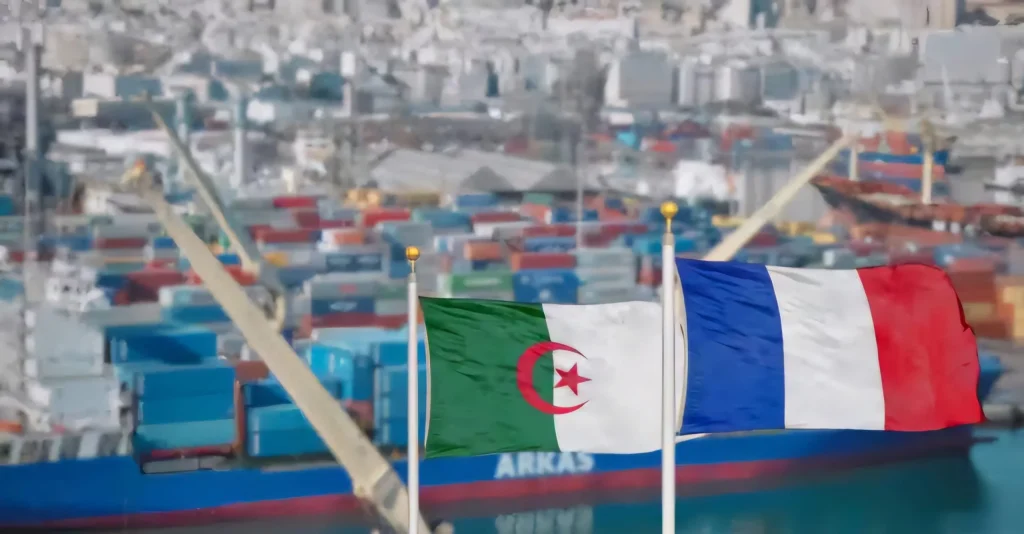
Un commentaire
I’ve been on the Algerian Farmers Market in Paris, yesterday. The yellow peaches give it away: it’s poor quality produce. Else, they would sell yummie yellow peaches from China. Sorry. It sucks.